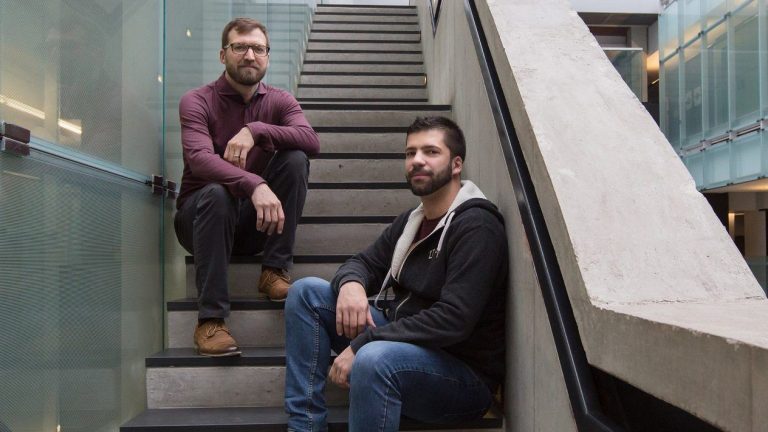Publié originalement le 8 mai 2018 sur InsideThePerimeter.ca.
Si vous demandez à un jeune chercheur ce qui le frustre le plus à l’heure actuelle, il ne parlera peut-être pas d’une formule complexe ou d’une théorie insoluble. Au lieu de cela, beaucoup sont contrariés par quelque chose de bien plus vaste : la structure de la science elle-même.
Alors que la société adopte les données ouvertes, les espaces communs de fabrication et les processus de collaboration, les fondements historiques de la science — départements universitaires, revues payantes, groupes à accès restreint — paraissent de plus en plus désuets.
De plus en plus de scientifiques font valoir qu’en changeant non seulement la manière de faire de la science, mais aussi de la diffuser, on susciterait beaucoup de nouvelles possibilités. Selon leur vision, cette nouvelle science serait ouverte sur le plan des méthodes et des pratiques.
D’autres domaines ont déjà adopté une philosophie d’ouverture : les logiciels libres (pensez à Linux et à GitHub) sont maintenant bien enracinés après avoir fait leur apparition sur la scène technologique à la fin des années 1980, et l’« innovation ouverte » est en progression. Par contre, la « science ouverte » commence à peine à gagner du terrain.
Une rencontre tenue à l’Institut Périmètre en avril visait à donner une impulsion à ce mouvement. D’une durée de 3 jours, la conférence Open Research (Science ouverte) a réuni 30 scientifiques, concepteurs et entrepreneurs venus tracer le portrait d’une réalité ouverte et trouver des moyens d’y parvenir.

Pour le physicien Matteo Smerlak, co-organisateur de la conférence, il ne s’agit pas d’une question ésotérique. Ses travaux pluridisciplinaires touchent plusieurs spécialités, de sorte qu’il doit souvent apprendre beaucoup de choses en peu de temps. Dans le cas de domaines bien établis, des livres et monographies sont disponibles, mais il y a peu de ressources faisant autorité sur des sujets de pointe. Il faut se fier à un flot d’articles de recherche — dont plusieurs peuvent se chevaucher ou se contredire. Au cours des dernières années, ce flot est devenu un torrent incontrôlé, à cause de la prolifération de publications en ligne et de la montée des publications prédatrices.
Pendant ce temps, à cause de la philosophie « publier ou périr » du milieu universitaire, les jeunes chercheurs se sentent obligés de consacrer des années cruciales de leur carrière à se monter une liste de publications. Cela signifie souvent de s’en tenir à des recherches incrémentales « sûres » susceptibles d’être publiées et d’éviter les travaux plus risqués dont les dividendes scientifiques pourraient être plus élevés. Et la complexité croissante de la science elle-même ne fait qu’ajouter au problème.
Selon M. Smerlak, si on enlevait les obstacles qui se dressent devant les chercheurs potentiels, ou qui nuisent à la circulation des idées, la science pourrait devenir plus universelle et innovatrice. « Une bonne partie de la science, a-t-il déclaré, consiste à savoir à quels problèmes il vaut la peine de s’attaquer. Ce n’est pas seulement une question de compétences ou de données; c’est le fait de participer à une conversation contemporaine et vivante. » [traduction]
M. Smerlak ajoute que malgré tout leur talent, les chercheurs des pays en développement sont trop souvent confinés à l’étude de problèmes anciens. Une grande partie des recherches de pointe commencent par une conversation lors d’une conférence ou d’une visite à un institut. Un chercheur qui n’est pas physiquement présent ou auquel les personnes impliquées ne pensent pas risque d’être laissé de côté.
« Avec Internet, a-t-il ajouté, il devrait être possible de diffuser les sujets de recherche à mesure qu’ils sont soulevés et de les ouvrir à des contributions externes. Il y a là des compétences que nous n’exploitons pas. » [traduction] (La base de données PIRSA de l’Institut Périmètre vise à combler cette lacune en diffusant gratuitement des exposés et discussions de pointe.)
Mais selon Benedikt Fecher, responsable de la recherche sur les dimensions du savoir à l’Institut Alexander-von-Humboldt sur Internet et la société, faire plonger les chercheurs dans la science ouverte, c’est comme d’attendre qu’un premier pingouin plonge de la banquise.
Tout comme les pingouins ont peur d’être dévorés par un requin, les scientifiques ont peur qu’un collègue utilise leurs données pour publier en premier (et ainsi prendre de l’avance dans la course aux postes permanents ou aux subventions). Ils craignent aussi de ne pas recevoir une juste reconnaissance de leurs idées. Lors d’un atelier auquel il a participé, M. Fecher a ajouté que des gens en principe d’accord avec l’idée d’ouverture sont réticents à la mettre en pratique.
« Il y a un idéal d’ouverture, a-t-il déclaré, et un espace où elle peut valoir la peine et être pertinente. » [traduction]
La complexité exige la collaboration
La science se complexifie, et il en va de même des problèmes auxquels les chercheurs font face. De l’astrophysique à l’épidémiologie, en passant par les changements climatiques, les données massives produites par certaines expériences ouvrent des pistes qui permettent de s’attaquer à des problèmes complexes inabordables dans le passé.
Selon Bapu Vaitla, co-organisateur de la conférence, alors que les progrès scientifiques étaient autrefois le fait d’individus et de petites équipes, la complexité des découvertes actuelles exige des collaborations à l’échelle mondiale.
À titre de chercheur à l’École T.H.-Chan de santé publique de l’Université Harvard, M. Vaitla étudie les liens entre deux réalités extrêmement complexes : la santé humaine et la santé des écosystèmes. Il s’agit de travaux qui font intervenir une intense collaboration couvrant des domaines aussi divers que la modélisation théorique et l’océanographie.
« Je crois que l’accélération du progrès scientifique dépend fortement de notre capacité à créer des réseaux de collaboration, a-t-il déclaré. En démocratisant l’énoncé des problèmes et en invitant tout le monde à contribuer à la solution, on constate que les problèmes sont résolus plus rapidement, que les erreurs sont corrigées sans tarder et que la science progresse plus vite. » [traduction]

Cela ne concerne pas seulement les nouveaux projets de recherche. L’un des principaux défis de la science ouverte — et en même temps l’une de ses plus grandes promesses — consiste à trouver un moyen de relier des gens à des travaux scientifiques déjà en cours. Selon Simon DeDeo, directeur du Laboratoire de la conscience sociale de l’Université Carnegie-Mellon, plus le nombre de personnes qui peuvent y participer est important, meilleurs seront les résultats.
« Tout scientifique du monde développé — au Canada, aux États-Unis, et certainement en Europe —, a t-il déclaré, reçoit constamment des courriels de jeunes scientifiques de pays comme l’Inde et la Chine, qui aimeraient créer des liens avec nos activités scientifiques.
« Ce genre de liens, cette démocratisation, cette mondialisation de la science, ne peuvent être soutenus par un modèle qui date de 1830. » [traduction]
La science a déjà connu de telles révolutions. À la fin du XVIIe siècle, la Société Royale d’Angleterre a été fondée avec la devise « nullius in verba » (ne croire personne sur parole). Elle reposait sur la République des Lettres et encourageait les échanges d’idées. Puis est apparue la revue scientifique, et avec elle le besoin de publier des résultats.
« Nous avons le sentiment d’avoir besoin de quelque chose de neuf, a poursuivi M. DeDeo. L’un des grands défis, et en même temps l’une des grandes occasions que nous avons, ne réside pas seulement dans des données ouvertes et dans un libre accès aux publications. Nous devons nous demander comment repenser la collaboration, l’ouverture scientifique, pour le XXIe siècle. » [traduction]
De jeunes pousses entrent en scène
Thomas Landrain a vu de près les effets de la science ouverte. Biologiste de synthèse, il a mis sur pied pendant ses études de doctorat un laboratoire ouvert appelé La Paillasse, dont les activités ont commencé avec quelques personnes, du matériel de laboratoire remis à neuf et un squat dans un sous sol.
Les années qui ont suivi ont produit des résultats extraordinaires. Le premier projet — mis sur pied pendant le scandale européen de la viande de cheval — consistait en un test diagnostique bon marché pour déterminer les types de viande. Il y a eu ensuite une collaboration avec l’Université d’État de New York (SUNY) sur l’électronique biodégradable, puis un projet de production d’encre à partir de bactéries plutôt que de produits pétrochimiques (qui a donné naissance à l’entreprise Pili), de même qu’un projet financé par la NASA pour concevoir un bioréacteur à source ouverte.
« Lorsque nous avons créé le laboratoire, a-t-il déclaré, je m’attendais à ce que surtout des biologistes viennent, mais nous avons eu une majorité de non-biologistes. C’étaient des gens qui voulaient faire de la biologie, mais qui n’avaient jamais pu en faire auparavant. » [traduction]

En 2014, La Paillasse a déménagé dans des locaux officiels au centre de Paris. Un an plus tard, le laboratoire a conclu un partenariat avec la société pharmaceutique Roche pour lancer le programme Epidemium, qui utilise des données massives afin d’analyser l’épidémiologie du cancer. Plus de 300 personnes ont participé à ce programme. La plupart étaient des professionnels non scientifiques. L’un des principaux projets a été réalisé par une équipe de spécialistes des données travaillant pour une banque. Un autre a vu la participation de Marthe Gautier, codécouvreuse du syndrome de Down et retraitée depuis longtemps.
« Ce n’est pas de la science citoyenne, a déclaré M. Landrain. La science citoyenne consiste à simplifier un problème jusqu’à ce qu’il soit à la portée des gens. Dans ce cas-ci, la recherche brute demeure dans toute sa complexité. Mais toute personne qui le souhaite peut y participer. » [traduction]
La rigueur scientifique n’était pas la préoccupation première du laboratoire. Ce qui comptait, c’était de lancer des défis et de trouver l’infrastructure nécessaire pour faire de la recherche et produire des innovations. Jusqu’à maintenant, cela a donné des résultats solides. « Chaque fois que nous avons essayé de travailler dans une collectivité d’une manière très ouverte et dans un esprit de collaboration, a-t-il ajouté, cela a fonctionné à merveille. » [traduction]
Thomas Landrain vient maintenant de mettre sur pied Just One Giant Lab (JOGL), laboratoire de recherche et d’innovation qui vise à conclure des partenariats avec des universités, des entreprises, des fondations et des organismes à but non lucratif pour s’attaquer à de graves problèmes sociaux et environnementaux. Il considère que cet organisme complète le milieu universitaire, sans le remplacer.
« Nous avons besoin de chercheurs universitaires et nous avons besoin de chercheurs professionnels, a-t-il déclaré. Mais il ne devrait pas y avoir de monopole. Le savoir est infini. Alors pourquoi devrions-nous limiter le nombre de chercheurs? » [traduction]
Le besoin de cohésion
JOGL n’est qu’un organisme parmi d’autres dans le domaine de la science ouverte. Des représentants de diverses jeunes pousses dans le domaine du partage de connaissances et de la science ouverte telles que Open Parallel, CTRL Labs et Knowen ont également participé à la conférence.
On peut considérer que ces premières incursions tangibles dans le domaine de la science ouverte constituent un appui prometteur de l’idée, mais elles posent également des problèmes.
En l’absence d’un environnement technique dominant, la communauté scientifique risque de se fractionner selon environ une douzaine de technologies. Les barrières entre ces environnements techniques viendraient alors annihiler les efforts en faveur de la collaboration. Les chercheurs resteraient confinés dans des silos, séparés par des parois technologiques et peu informés des travaux de leurs collègues.
Il y a aussi la question de savoir qui paie pour la science ouverte. À l’heure actuelle, la plupart des chercheurs font aussi de l’enseignement ou travaillent dans des entreprises. Dans les laboratoires de Thomas Landrain, les chercheurs sont bénévoles et comptent sur leur emploi de jour pour vivre. « Les gens le font bénévolement, a-t-il déclaré, parce qu’ils savent que c’est pour un plus grand bien. Il n’y a aucune exclusivité. Tout repose sur des données ouvertes, tout ce qui est produit est accessible à tous. Nous disons clairement que nous n’allons rémunérer personne, mais que nous allons donner à chacun la chance d’avoir du plaisir et d’apprendre, et de faire valoir ses talents ou son imagination. » [traduction]
Le mouvement en faveur de la science ouverte comporte aussi le danger de répandre sans le vouloir l’un des problèmes les plus difficiles de la science actuelle : son manque de diversité. Comme l’a fait remarquer la microbiologiste Rosie Redfield, de l’Université de la Colombie-Britannique, ceux qui font les normes les façonnent à leur image.
La science actuelle a tendance à favoriser un certain type de personnes : des gens instruits, privilégiés, venant de pays développés, souvent blancs, généralement des hommes. (À titre d’exemple, un article récemment paru dans Nature Communications a montré que les femmes n’obtiennent pas autant d’occasions de prendre la parole dans des conférences.) Sans une plus grande diversité dès le début, les outils et processus de la science ouverte risquent d’incorporer les mêmes préjugés.
Mme Redfield — qui tient un blogue sur ses travaux de laboratoire et qui a été la seule femme à faire un exposé pendant les 3 jours de la conférence — affirme qu’une plus grande diversité n’est pas synonyme de normes scientifiques moins élevées. Il suffit d’être sensibilisé à l’importance de la diversité et de faire preuve de vigilance.
« Il faut contrer les préjugés intrinsèques, implicites et inconscients, a-t-elle déclaré. Ce n’est pas qu’un problème d’hommes. Nous avons tous ces préjugés inconscients. Les femmes sont simplement plus conscientes d’être lésées par ces préjugés et travaillent plus fort pour les vaincre.
« Les bonnes intentions ne suffisent pas. Il faut faire des efforts délibérés. » [traduction]
Les dividendes seront surtout pour les jeunes
Jusqu’à maintenant, comme on pourrait s’y attendre, c’est l’establishment qui s’oppose le plus manifestement à la science ouverte.
Les revues spécialisées ne veulent pas céder leur mainmise sur la communication scientifique et les énormes profits qui en découlent. Les chercheurs de longue expérience qui ont consacré leur carrière à la mise sur pied d’ensembles de données sont réticents à les partager.
Selon Bapu Vaitla, ce sont surtout de jeunes chercheurs qui favorisent le changement. « Pour moi, a-t-il déclaré, le principal résultat de la conférence, c’est que, davantage que la création d’outils, l’évolution des normes constitue le principal obstacle à la progression de la science ouverte. »
De manière peut-être surprenante, M. Vaitla estime que les physiciens théoriciens sont particulièrement bien placés pour mener la charge. « Par rapport à d’autres scientifiques, a-t-il ajouté, les physiciens théoriciens utilisent moins de données tel que nous l’entendons généralement. Le partage de données ne pose pas autant de problème.
« Je crois que les physiciens théoriciens peuvent être à l’avant-garde de ce mouvement, parce qu’ils peuvent mettre le doigt sur un sous-ensemble de problèmes qui sont peut-être un peu plus faciles à résoudre et susceptibles de créer une certaine dynamique. » [traduction]
Pour Matteo Smerlak, la conférence Open Research (Science ouverte) a constitué une modeste première étape. Tous les participants ont reconnu qu’il reste beaucoup de travail à faire pour que leur vision devienne réalité, mais autant les universitaires que les fondateurs de nouvelles entreprises semblaient impatients de relever le défi. Les participants à la conférence comptent produire un livre blanc à partir de leurs échanges, afin de susciter davantage de discussions et d’action.
« Chez les témoins à distance comme chez les acteurs impliqués de près, a déclaré M. Smerlak, il y a un fort désir de se rassembler.
« Le logiciel libre est mû par une philosophie très explicite, à laquelle les principaux acteurs du domaine souscrivent largement. Les scientifiques ont aussi une philosophie commune en ce qui concerne les échanges d’idées, le scepticisme, la reproduction de résultats et leur remise en question. Il n’y a aucune raison pour laquelle nous ne pourrions pas avoir une philosophie commune en ce qui concerne la science ouverte. » [traduction]
– Tenille Bonoguore